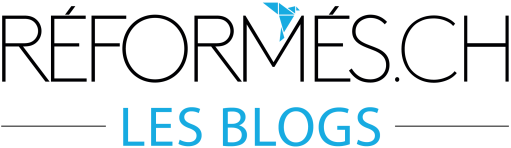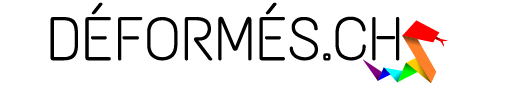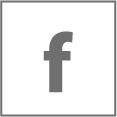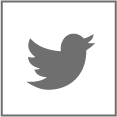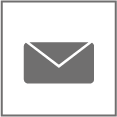Le pardon, mode d'emploi
Traditionnellement associé à la sphère religieuse, le pardon revêt aujourd’hui de nouvelles dimensions. Délaissant ses habits de vertu chrétienne, il se glisse dans les cercles de thérapie, les pratiques de justice restaurative ou les ateliers de développement personnel. Mais cette évolution ne va pas sans résistances. «Beaucoup associent le pardon à une obligation morale ou religieuse culpabilisante. Il arrive même qu’on s’en détourne, alors qu’il s’agit avant tout d’un processus de guérison», observe Olivier Clerc, fondateur des Cercles de pardon. Le pardon dérange, questionne, parfois choque – comme s’il en demandait trop à des sociétés hantées par les blessures personnelles ou historiques.
Pourtant, pour le théologien Jacques Buchhold, auteur de Le pardon et l’oubli (Ed. Terre nouvelle, 2002), il reste un pilier de toute relation humaine. «Outre la dimension verticale que les chrétiens donnent au pardon, et qui se joue dans la relation à Dieu, il y a une dimension horizontale du pardon qui se passe entre êtres humains, et sans laquelle les relations entre ces derniers seraient impossibles.» Une conviction partagée par la philosophe juive Hannah Arendt, que cite le jésuite Guilhem Causse, professeur aux Facultés Loyola à Paris. «Bien que peu suspecte de religiosité, elle reconnaissait au pardon pratiqué par Jésus une possibilité humaine fondamentale: celle de dépasser la logique de la dette et de la vengeance», résume l’auteur de Le pardon et la victime relevée, (Ed. Salvator, 2019).
Tout pardonner?
Mais dans une époque où le moi est roi et où le ressenti individuel fait souvent office de vérité ultime, est-il encore possible de pardonner? «Le pardon est d’abord une expérience de l’altérité», explique Guilhem Causse. «Il suppose que l’on reconnaisse la personne blessante comme un sujet, pas seulement comme définie par son acte. Or aujourd’hui, cette prise de conscience est de plus en plus difficile, à cause de l’individualisme ambiant. Du côté des victimes aussi, le chemin est escarpé. Pour Guilhem Causse, envisager de pardonner, «c’est faire l’expérience que du bon et du nouveau peuvent renaître en soi malgré ce qu’on a subi.» Mais cela demande du temps: «Le pardon suit des étapes semblables à celles du deuil. Et ce qui semble impardonnable aujourd’hui peut devenir, un jour, objet de pardon.»
Mais peut-on tout pardonner? C’est la question qui tue. Pour Olivier Clerc, elle est mal posée. «Refuser de pardonner, c’est refuser de guérir! Car pardonner, pour moi, ne veut pas forcément dire cautionner. Cela permet de retrouver la paix intérieure.» Dans un de ses livres, il propose cette image: «Se priver du pardon, c’est comme refuser de soigner une blessure au cœur. On croit punir l’autre, mais on s’empoisonne soi-même.»
Pour Jacques Buchhold, la condition première, pour pardonner, reste la reconnaissance de la faute: «Sans cela, il ne peut pas y avoir de pardon véritable. Mais si cette reconnaissance a lieu, alors tout est pardonnable.» Il cite l’histoire de Corrie ten Boom, écrivaine réformée survivante des camps nazis: «Lorsqu’un ancien bourreau est venu lui demander pardon, elle a tendu la main. Quelque chose d’extraordinaire s’est produit: c’était le début d’une vraie réconciliation.» Du côté scientifique, Petra Klumb, professeure ordinaire de psychologie à l’Université de Fribourg, confirme l’importance de voir le pardon demandé par la personne qui a blessé: «On ne peut forcer personne à pardonner. Toutefois, un facteur qui m’intéresse dans mes recherches est celui de la réparation. Si la personne qui a offensé une autre personne reconnaît sa responsabilité et exprime qu’elle regrette son comportement, cela aide la personne concernée à pardonner.»
Libération intérieure
Les effets du pardon ne seraient d’ailleurs pas que symboliques. Selon Olivier Clerc, ces derniers seraient même mesurables. «Le pardon agit comme un allègement, et ses effets peuvent être physiques, jusqu’à allonger l’espérance de vie», affirme-t-il. «C’est comme poser un fardeau que l’on portait depuis des années. Ne pas pardonner, c’est garder l’infection en soi. Des études indiquent qu’il diminue le stress chronique, améliore la qualité du sommeil et favorise la résilience psychologique.» A son tour, Petra Klumb évoque des recherches scientifiques au sujet du pardon, qui «confirment son pouvoir soulageant, notamment lorsqu’il permet de résoudre un conflit ou de tourner la page sur une situation problématique». Et Guilhem Causse d’abonder: «Il permet la fin de la rancune, un apaisement, et la réintégration de soi. C’est une forme de résilience qui permet à nouveau de vivre avec les autres. En cela, le pardon n’efface pas le passé, mais le transforme.»
Enfin, si le pardon est une voie possible afin de résoudre des conflits, il ne devrait toutefois pas devenir une injonction selon Guilhem Causse: «Quand l’Eglise impose le pardon comme un devoir moral, elle le pervertit. Cela fait du mal, aux personnes comme au message même de l’Évangile. Cela peut constituer un véritable obstacle au pardon authentique.» Olivier Clerc préfère l’invitation à l’expérimentation. Ses Cercles de pardon permettent à des personnes d’en faire l’expérience concrète, en dehors de tout cadre religieux, mais sans toutefois le renier. «On ne peut pas toujours réparer ce qui a été détruit. Mais en pardonnant, on peut vivre autrement avec ce qui a eu lieu.»