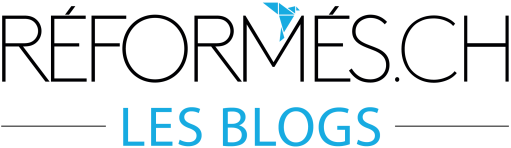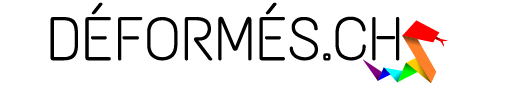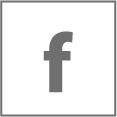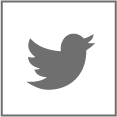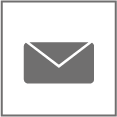Droits de l’enfant: raviver un élan mondial en perte de souffle

Pour Philip Jaffé, élu au Comité des droits de l’enfant en 2018, l’un des principaux obstacles réside dans une forme de fatigue collective: «Il existe encore des professionnels enthousiastes et engagés, mais l’élan général s’est affaibli. Après un âge d’or des droits de l’enfant, nous sommes désormais dans une posture défensive. Les priorités politiques se déplacent vers l’économie ou la sécurité, au détriment des enjeux psychosociaux.»
Cette démobilisation s’explique aussi par un paradoxe troublant: la résilience de certaines victimes nourrit l’idée qu’il est possible de «survivre» à une enfance maltraitée, ce qui banalise les violences ordinaires. À cela s’ajoute une accoutumance sociale face aux violences extrêmes, notamment dans les zones de conflit: «On tolère davantage l’intolérable, parce que l’impuissance semble devenir la norme», déplore Philip Jaffé.
Prévenir la violence dès le plus jeune âge
Sabine Rakotomalala, qui coordonne des actions de prévention à l’OMS, insiste sur la méconnaissance du coût humain et sociétal des violences infantiles: «Beaucoup ne mesurent pas l’impact durable d’une enfance maltraitée sur la vie adulte: santé, emploi, économie, cohésion sociale. Ce manque de compréhension alimente le désintérêt.» Elle identifie trois leviers concrets, validés par la recherche et les programmes internationaux.
Premier levier: l’appui à la parentalité: dix sessions de soutien peuvent déjà réduire significativement la violence domestique. Deuxième levier: la présence d’adultes formés dans les écoles – infirmières, enseignants capables d’écouter et d’orienter les enfants vers des ressources psychosociales. Et troisième levier: le renforcement des services sociaux, juridiques et de santé pour répondre rapidement aux situations de maltraitance. Sur ces points, Philip Jaffé complète: «L’intervention précoce est cruciale: même les microviolences du quotidien laissent des traces qui peuvent s’aggraver avec le temps.»
La lutte contre la violence n’a de sens que si elle dépasse les frontières. Sabine Rakotomalala souligne le rôle de grandes conférences comme celle organisée à Bogotá en novembre 2024 avec l’OMS, l’UNICEF et le Rapporteur spécial de l’ONU sur la violence à l’encontre des enfants. L’événement a réuni 1500 participants, dont 80 ministres et 120 pays: «Ces espaces de dialogue créent un mouvement mondial. Sans coordination, nous n’atteindrons jamais le «tipping point» (seuil critique) où les gouvernements se sentent obligés d’agir.» Philip Jaffé y voit même un moteur: une «compétition saine» entre Etats pour devenir pionniers en matière de protection de l’enfance, un levier efficace lorsqu’il est alimenté par l’exemplarité.
La Suisse, entre valeurs universelles et lenteur pragmatique
Pays hôte de nombreuses organisations internationales, la Suisse occupe une place symbolique forte. Mais sa réalité interne est plus nuancée. «La Suisse défend les droits humains sur la scène mondiale, mais reste prudente dès qu’il s’agit d’intervenir dans la sphère privée des familles. Nous avançons millimètre par millimètre», explique Philip Jaffé. L’exemple du châtiment corporel est révélateur: longtemps à la traîne, la Suisse vient seulement d’inscrire dans la loi son interdiction, devenant le 70ᵉ pays sur 195 à le faire. La mise en œuvre est prévue pour janvier 2026. Sabine Rakotomalala y voit malgré tout un signe positif: «Quand la Suisse agit, elle le fait avec rigueur. Ce sera un test pour voir comment un pays décentralisé met en œuvre une telle loi.»
Redonner la parole aux enfants, une urgence démocratique
Au-delà des lois et des programmes, les deux experts insistent sur l’importance de la participation des jeunes. «Arrêtons de faire semblant. Impliquons-les dans la conception des projets scolaires, parentaux, communautaires», plaide Sabine Rakotomalala. Philip Jaffé ajoute la nécessité d’un accès réel à la justice pour les enfants et salue différentes initiatives dites de «prospective» qui permettent à des jeunes d’imaginer le futur et de formuler les contours de la société de demain: «Il faut écouter les jeunes qui réfléchissent au monde dans 20 ou 30 ans. Ils apportent des idées créatives que les adultes n’osent plus formuler.»
Abus sexuels envers les enfants en Suisse: que nous apprennent les données de l’étude Optimus?
La Suisse dispose désormais de données solides sur l’ampleur des violences sexuelles faites aux enfants, grâce à l’étude Optimus, la première enquête représentative menée auprès d’élèves de 9e année. Ces résultats, publiés par des institutions spécialisées dans la protection de l’enfance et relayés par l’OMS et le Conseil de l’Europe, révèlent une réalité préoccupante.
Une prévalence élevée des violences sexuelles
Selon l’enquête menée auprès de 6700 adolescents âgés de 15 à 16 ans :
- 22 % des filles et 8 % des garçons déclarent avoir subi des violences sexuelles avec contact physique avant l’âge de 16 ans. Ces chiffres concordent avec les estimations internationales (Conseil de l’Europe, OMS).
- Les formes sans contact physique, telles que le harcèlement sexuel en ligne, l’exhibitionnisme ou l’envoi d’images sexuelles – touchent encore plus largement, dépassant 30 % chez les filles.
- Les experts estiment qu’au total, 20 à 30 % des mineurs ont subi une forme de violence sexuelle au moins une fois.
Ces données confirment que les violences sexuelles contre les enfants ne sont pas des situations isolées mais un problème majeur de santé publique et de protection de l’enfance.
Des milliers d’enfants concernés par la maltraitance chaque année
Chaque année, 30 000 à 50 000 enfants entrent en contact avec des organisations suisses de protection de l’enfance pour des situations de maltraitance (toutes formes confondues: négligence, violences psychologiques et physiques, abus sexuels, etc.).
Les chiffres disponibles pour 2016 révèlent la répartition suivante des cas signalés :
Négligence: 22 %
Violences sexuelles:15 %
Violences psychiques: 19 %
Violences physiques: 20 %
Enfants témoins de violences conjugales: 19 %
A cela s’ajoutent 10 à 15 % de situations de harcèlement entre pairs (bullying), souvent liées à des violences psychologiques ou à des agressions en ligne.
Un enjeu majeur de prévention et de sensibilisation
Ces chiffres rappellent l’importance de:
- La prévention précoce: éducation à la sécurité corporelle (comme la « règle du sous-vêtement » promue par le Conseil de l’Europe), programmes de sensibilisation dans les écoles.
- Le renforcement des dispositifs de signalement: lignes d’écoute, plateformes de soutien aux enfants et aux familles.
- La formation des professionnels: enseignants, travailleurs sociaux, médecins et forces de l’ordre doivent être formés à repérer et signaler les signes d’abus.
La maltraitance infantile – en particulier les violences sexuelles – reste un sujet tabou. Pourtant, une meilleure information et une prise en charge précoce peuvent réduire considérablement les conséquences psychologiques à long terme chez les victimes.
Sources principales
A ne pas louper
CINÉMA Les 19 et 20 novembre, huit villes romandes vibreront au rythme de la Journée internationale des droits de l’enfant au cinéma. Projections et tables rondes mettront en lumière un sujet souvent relégué au second plan: la violence exercée contre les enfants. Au cœur de cette édition, le film belge On vous croit, signé Charlotte Devillers et Arnaud Dufeys, plonge dans le parcours d’Alice, une mère confrontée à un système judiciaire soupçonneux, davantage prompt à examiner sa crédibilité qu’à entendre les victimes. Sans artifice, le récit expose l’inertie et les paradoxes d’institutions censées protéger mais qui, parfois, exposent davantage qu’elles ne secourent. Après chaque projection, un temps d’échange avec des spécialistes de la protection de l’enfance et des jeunes engagés prolongera l’expérience.
A Genève, une table ronde réunira la spécialiste de la protection de l’enfance Sabine Rakotomalala et Philip Jaffé du Comité des droits de l’enfant, le 19 novembre, à 20h30. Le lendemain, d’autres rencontres auront lieu à Bienne, Berne et La Chaux-de-Fonds, dès 17h30, puis à Delémont, à 20h, et à Neuchâtel, Fribourg, Vevey et Sion, à 20h15.
Au cœur de cet événement, le cinéma se révèle un outil puissant pour faire évoluer les normes sociales. «La culture change les valeurs. Mais faut-il montrer la violence ou privilégier des récits protecteurs comme The Kid de Chaplin? La stratégie reste à affiner, surtout pour toucher les jeunes, futurs parents», s’interroge Sabine Rakotomalala. Pour Philip Jaffé, ces moments collectifs de visionnage sont essentiels: «Ils génèrent une responsabilisation sociale, une prise de conscience commune.» Plus d’informations
EXPO Le 30 octobre 2025 s’ouvre au Musée Historique Lausanne (place de la cathédrale 4) l’exposition itinérante «Placés, internés, oubliés?», consacrée à un chapitre longtemps méconnu de l’histoire suisse: les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux. Elle retrace non seulement ces pratiques qui ont marqué des milliers de vies, mais aussi le processus de reconnaissance et de mémoire entrepris depuis quelques années.
S’appuyant sur une approche scientifique et une riche mosaïque de témoignages, l’exposition entend donner une voix aux personnes concernées. Récits intimes et analyses historiques se croisent pour éclairer l’impact durable de ces politiques sur les individus et la société. Plus qu’une rétrospective, «Placés, internés, oubliés?» ouvre des espaces de réflexion. Elle invite les visiteurs à interroger la possibilité de réparer les injustices du passé et à réfléchir aux moyens d’éviter qu’elles ne se répètent. Le parcours revient également sur les étapes politiques ayant conduit à la reconnaissance officielle de ces torts. Cette initiative s’inscrit dans le programme national «Se souvenir pour l’avenir», qui vise à préserver la mémoire collective et à favoriser un dialogue critique autour des erreurs du passé.
EXPO Le Musée d’Histoire de Berne (Helvetiaplatz 5) accueille l’exposition itinérante «Les laissés-pour-compte du bonheur. Mesures de coercition à des fins d’assistance à Berne et en Suisse», visible jusqu’au 11 janvier 2026. Elle revient sur les placements forcés, les mises sous tutelle et la privation de droits civils imposés, jusque dans les années 1970, à des centaines de milliers d’enfants, d’adolescent·es et d’adultes jugés «hors normes». Le canton de Berne, particulièrement touché, compte à lui seul plus de 50 000 victimes de ces mesures, soit un nombre largement supérieur à la moyenne suisse. L’exposition raconte cinq parcours de vie marqués par ces décisions administratives, auxquels s’ajoutent deux destins bernoises inédits pour cette étape locale.
Les visiteurs plongent dans des reconstitutions immersives – étable, cuisine, buanderie – nourries d’archives et de témoignages audio. Une installation baptisée «Les noms des personnes oubliées», composée de 10 826 points blancs, rend hommage aux bénéficiaires des contributions de solidarité fédérales et met un visage sur ces injustices longtemps passées sous silence. L’initiative s’inscrit dans un mouvement national de reconnaissance des victimes. Depuis 2017, la Confédération octroie des contributions de solidarité; plus de 11 000 ont été acceptées, dont un cinquième pour des personnes bernoises.