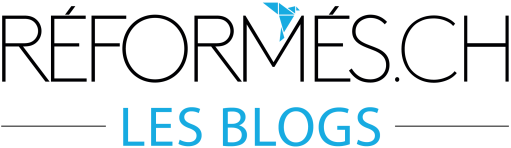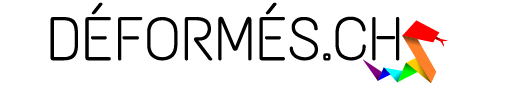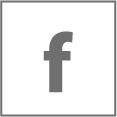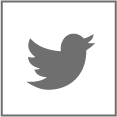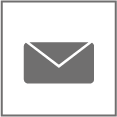Pas de «thérapies de conversion» à l'américaine en Suisse romande
En Suisse romande, les «thérapies de conversion» ne prennent pas la forme de stages structurés, comme ceux documentés aux Etats-Unis, mais des pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre existent bel et bien. C’est ce que met en lumière une enquête en cours menée par le Centre intercantonal d’information sur les croyances (CIC) dans les cantons de Vaud et Genève. Le mercredi 7 mai, un colloque organisé à l’Université de Lausanne s'est interrogé sur ce que sont ces accompagnements dits «psycho-spirituels». Le titre choisi pour cette journée d’étude, «Thérapies de conversion», reprenait ainsi un terme largement médiatisé mais jugé imprécis par les chercheurs en ce qui concerne les pratiques ayant cours en Suisse romande. Initialement attendus à l’automne 2025, les résultats de cette recherche, sous forme d’appel à témoins, seront publiés au printemps 2026. Philippe Gilbert, chercheur au CIC, en livre les premiers enseignements. Interview.
Votre enquête sur les thérapies de conversion a-t-elle montré que ces pratiques étaient réelles sur le territoire suisse?
La recherche du CIC porte plus globalement sur les accompagnements psycho-spirituels ayant pour but d’intervenir sur les questions d’orientation affective et sexuelle, ou d’identité de genre, en contexte spirituel et religieux, dans les cantons de Vaud et Genève. Et effectivement, durant notre enquête, nous avons pu constater de telles pratiques, que nous ne nommons pas pour autant «thérapies de conversion».
Sur votre site, vous indiquez que les thérapies de conversion sous forme de stages structurés à l’américaine n’existent pas en Suisse. Qu’observez-vous concrètement?
Nous n’avons pas connaissance, à l’heure actuelle, dans les cantons de Vaud et Genève, de pratiques s’apparentant à des programmes psychothérapeutiques comparables à ce qui a pu être constaté aux Etats-Unis – comme ceux illustrés dans des films tels que Boy Erased. En revanche, nous avons recueilli des témoignages récents de personnes à qui l’on a proposé de «soigner» ou d’«atténuer» leur orientation sexuelle. Cela peut prendre la forme de prières, de séances de «soins» ou de conseils délivrés dans divers contextes.
Dès lors, n’est-il pas imprécis d’utiliser le terme «thérapies de conversion»?
Peut-être par commodité, la presse emploie ce terme. Mais dans la plupart des cas, il s’agit de désigner, pour reprendre les termes de l’article 71a de la loi sur la santé publique votée par le Grand Conseil vaudois en octobre dernier, «toute pratique visant à modifier ou réprimer l’orientation affective et sexuelle ou l’identité de genre d’autrui». Le terme «thérapies de conversion» n’y figure d’ailleurs pas.
Quel volume ces pratiques représentent-elles en Suisse?
Il est difficile de l’évaluer à l’échelle nationale. Notre recherche est qualitative, pas quantitative, et se concentre sur les cantons de Vaud et Genève. L’objectif est de comprendre les logiques, les discours, les représentations, afin d’élaborer une typologie des pratiques, utile à la prévention et à la détection des risques – ce qui correspond à notre mission. On peut toutefois citer une donnée du Swiss LGBTIQ+ Panel 2023, selon laquelle 9,5% des membres des minorités sexuelles et 15,5% des membres des minorités de genre ont déclaré avoir participé à des efforts visant à modifier ou à supprimer leur orientation sexuelle et/ou leur identité de genre.
En Suisse romande, on cite souvent l’association évangélique Torrents de vie. Votre enquête révèle-t-elle d’autres structures?
Torrents de vie, effectivement active par le passé, a cessé ses activités depuis plusieurs années. Nous n’avons pas identifié aujourd’hui de programmes comparables dans les cantons de Vaud et Genève. Toutefois, certains contextes socio-religieux semblent accueillir des formes d’accompagnements psycho-spirituels comme ceux que nous étudions.
Ces pratiques ne sont donc pas limitées au milieu évangélique?
Non. Si de nombreux témoignages proviennent de contextes évangéliques, nous avons également connaissance de pratiques similaires dans d’autres milieux spirituels, notamment ceux relevant de nouvelles spiritualités.