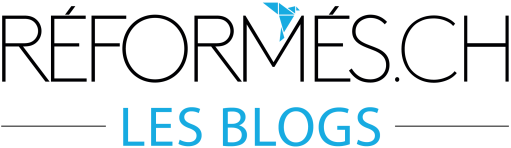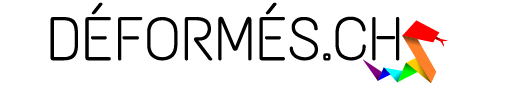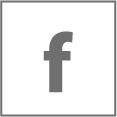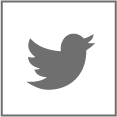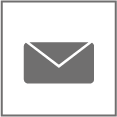Abus en Eglise: le chemin de la justice restaurative
Pendant des décennies, les victimes d’abus se sont tues. Aujourd’hui, des voix s’élèvent pour réclamer plus encore qu’une justice pénale, souvent perçue comme insuffisante pour panser les blessures des victimes. Apparue aux Etats-Unis dans les années 1970, la justice restaurative propose une approche complémentaire, centrée sur l’écoute, la reconnaissance et la réparation des préjudices, sans diminuer la responsabilité des auteurs.
«La justice restaurative commence par un droit à l’écoute», explique Chantal Eberlé, présidente de l’Eglise protestante de Genève (EPG), qui a organisé une journée de sensibilisation sur les abus le 29 mars dernier. Pour elle, il s’agit d’identifier les risques dès qu’il y a une relation d’ascendant et de proposer un espace où les victimes peuvent s’exprimer. «Nous allons encore nous améliorer. Pour le moment, il existe dans notre Eglise un système de signalement par mail, et je rencontre chaque personne pour écouter ses besoins, qu’il s’agisse de verbaliser sa souffrance ou d’envisager une réparation symbolique, comme des excuses ou une reconnaissance des torts.»
Camille Perrier Depeursinge, présidente de l’Association pour la justice restaurative en Suisse (AJURES), enseigne ce concept depuis 2015 à l’université de Lausanne. «La plupart des gens qui nous contactent sont des femmes victimes d’abus sexuels, souvent en quête d’un espace pour comprendre et se reconstruire», témoigne-t-elle. L’AJURES propose des processus concrets, basés sur le volontariat. «On commence par un entretien pour clarifier les attentes. C’est un processus lent, respectueux, où une rencontre entre victimes et auteurs n’est pas systématique.»
Justice complémentaire
Contrairement à la justice pénale, focalisée sur la sanction, la justice restaurative met les personnes au centre. «La justice pénale reconnaît le statut de victime, mais ne répond pas aux préjudices émotionnels ou à la perte de dignité», souligne Janie Bugnion, médiatrice, membre de l’association française Justice autrement et du Swiss Restorative Justice Forum. Elle rapporte le témoignage poignant d’une victime d’abus dans l’Eglise catholique: «Lors d’une séance, j’ai pardonné à mon agresseur. C’était d’abord un pardon à moi-même, une libération de la culpabilité que je portais malgré moi depuis des années.» Pour Janie Bugnion, «la justice restaurative n’a pas pour but le pardon, mais il peut surgir spontanément et permettre à la victime de se détacher du passé, et à l’auteur de saisir l’impact de ses actes.»
Camille Perrier Depeursinge insiste sur la complémentarité avec la justice pénale: «Ce n’est pas à la place, c’est autre chose. Les victimes disent souvent qu’après les procès, elles ne se sentent pas soulagées. Elles cherchent du sens.» Sylvie Perrinjaquet, présidente de la Commission d’écoute, de conciliation, d’arbitrage et de réparation (CECAR), qui s’occupe des affaires d’abus prescrites survenues en Suisse romande dans l’Eglise catholique, abonde: «Les victimes que nous recevons, souvent âgées, portent ce drame depuis des décennies. Leur besoin premier est que l’Eglise reconnaisse leur souffrance.»
Pour Marie-Claude Ischer, médiatrice, ex-présidente de l’Eglise protestante vaudoise (EERV) et membre du groupe de travail sur les abus pour la faîtière réformée suisse, la reconnaissance ne se limite donc pas seulement à un dédommagement financier. «Les victimes veulent parfois des excuses, une reconnaissance des torts, ou un acte symbolique. Il faut s’adapter à leurs besoins, construire avec elles.» Toutefois, comme le précise Sylvie Perrinjaquet, «l’indemnisation financière reste la première des demandes, souvent pour compenser le coût d’années de thérapies». La CECAR accompagne les victimes dans d’autres demandes variées, comme l’accès aux archives ou une rencontre encadrée avec une autorité ecclésiale. «Certaines victimes veulent parler à un évêque ou un représentant de la congrégation de l’abuseur si celui-ci est décédé.»
Le défi suisse
Janie Bugnion insiste sur la nécessité d’un cadre sécurisé: «Pour que le processus n’entraîne pas de nouvelles souffrances pour la victime, l’auteur doit reconnaître les faits, même s’il n’en assume pas la responsabilité.» La justice restaurative consiste donc à offrir un espace où victimes et auteurs peuvent dialoguer, donner un sens nouveau à leur vie, redevenir acteurs de leur histoire: «La victime n’est plus limitée à son statut de victime; l’auteur n’est plus réduit à son acte. C’est une humanisation réciproque.» Selon les témoignages, «la justice restaurative est la plus efficace dans les cas graves, là où le besoin de réparation est le plus grand».
Malgré ces avancées, la Suisse accuse un certain retard en matière de justice restaurative. «Il manque une impulsion fédérale. Tout repose sur des initiatives associatives, et le climat politique conservateur freine les progrès», regrette Camille Perrier Depeursinge. Une motion déposée en 2022 pour intégrer cette approche dans le droit suisse reste encore en attente. «Notre crainte est que le Conseil fédéral limite ce modèle aux petites infractions, ce qui serait réducteur.» En l’absence d’une volonté politique claire, ce sont aujourd’hui des institutions religieuses qui, paradoxalement, ouvrent la voie. Marie-Claude Ischer se réjouit que «les Eglises commencent à comprendre qu’il faut travailler avec les victimes, et non leur imposer des solutions. C’est un processus naissant, mais essentiel pour restaurer leur dignité.»