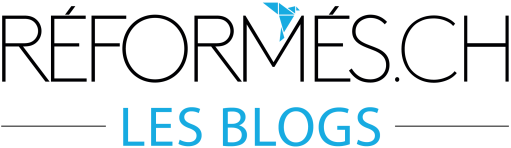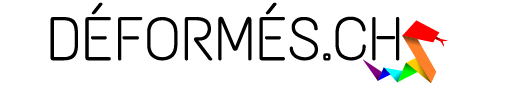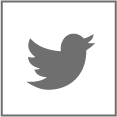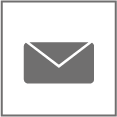Pape François: «Il était un peu comme un grand-père»
Pendant six années, Philippe Morard a exercé une mission peu commune: vice-commandant de la Garde suisse pontificale. Ancien analyste criminel pour la Police fédérale à Berne, aujourd’hui inspecteur de sinistres pour la compagnie d’assurances Helvetia, ce Fribourgeois discret, aujourd’hui âgé de 51 ans, a quitté la Suisse avec sa famille pour vivre dans une caserne au Vatican en 2015. Entre les voyages à haut risque, les rencontres officielles et les gestes simples du quotidien, il a côtoyé de près le pape François, dont il garde un souvenir ému. À l’annonce de son décès, il revient avec pudeur et émotion sur ces années hors du commun passées au service du Saint-Père.
Où étiez-vous lorsque vous avez appris la mort du pape François?
J’étais avec mon épouse pour rendre visite à mon oncle et ma tante. Nous étions dans la voiture et c’est en écoutant les nouvelles à la radio que nous avons appris son décès.
Quel a été votre premier ressenti?
Sur le moment, on n’y croit pas trop, d’autant qu’on l’avait vu la veille à la télévision. Puis, très vite, on réalise que non, ce n’était pas une fake news. C’est la réalité.
Le pape avait récemment montré des signes de faiblesse. Étiez-vous inquiet?
Oui, bien sûr. Dès le départ, on suivait avec attention l’évolution de sa santé. On lisait quotidiennement les bulletins médicaux publiés par le Vatican. Ce n’était pas de la curiosité mal placée, mais quand on a servi pendant des années auprès d’une personne, on reste attentif à ce qu’elle devient. On ne coupe pas complètement le lien.
Avez-vous eu des contacts personnels avec lui après votre départ du Vatican?
Une fois par an, on lui écrivait à Noël en famille — ce qui tombait aussi à l’époque de son anniversaire. Et chaque année, on recevait une réponse, rédigée par son secrétaire.
Quel souvenir vous est revenu en premier à l’annonce de sa mort?
La toute première rencontre. C’était le 3 juillet 2015, le jour de ma nomination. Mon épouse et moi nous sommes rendus à Rome, en toute discrétion. Le commandant m’avait demandé de n’en parler à personne, pas même à nos enfants. On avait inventé une excuse pour justifier notre absence. Le matin, après une discussion avec le commandant, on a eu l’occasion de saluer le Saint-Père, très rapidement, à la résidence de Sainte-Marthe. Ce contact m’a marqué, car je me disais : «Et s’il ne m’aime pas? Si ma tête ne lui revient pas?» Mais le commandant m’a rassuré: il était certain que le pape me ferait confiance.
En quoi consistait votre rôle de vice-commandant de la Garde suisse pontificale?
C’est le numéro deux: celui qui seconde le commandant, qui le remplace en cas d’absence. J’étais aussi chef d’état-major, responsable des séances, des finances, des affaires disciplinaires. Et j’accompagnais également le Saint-Père dans tous ses voyages.
Comment avez-vous été recruté?
J’ai postulé en tant qu’officier. Après un entretien avec le commandant, il m’a rappelé pour me proposer d’être son bras droit. C’était une opportunité. Je connaissais un autre ami qui avait été approché pour devenir officier, bien avant moi. Son épouse avait refusé de le suivre à Rome. Mais la mienne, à l’époque, avait dit: «Moi, je crois que j’aurais accepté.» Alors, quand le moment est venu, elle n’a pas hésité.
On dit de vous que vous êtes un homme très discret. Cela a-t-il joué en votre faveur?
Oui, la discrétion et l’humilité. C’est ce que recherchait le commandant. Pas quelqu’un d’ambitieux ou de prétentieux, mais une personne capable de s’intégrer, de s'adapter au monde clérical.
Comment décririez-vous le pape François dans les moments privés, en dehors du protocole?
C’était un homme très humain, avec beaucoup d’humour, très sensible. Et surtout, il avait une mémoire phénoménale. Il pouvait se souvenir du prénom d’un garde qu’il n’avait pas vu depuis deux ans. Ça, ça m’a toujours impressionné.
Avait-il une relation particulière avec les gardes?
Oui, il était un peu comme un grand-père avec eux. Il faut dire qu’il y avait une grande différence d’âge. Ces jeunes gardes, loin de leur famille, trouvaient en lui une figure paternelle. Il avait un contact facile, posait des questions, prenait des nouvelles. Il leur parlait vraiment.
Un soir, en semaine, il est même venu souper dans notre caserne. C’était à la bonne franquette, comme un curé qui vient manger avec ses fidèles à la salle de paroisse. Ce genre de gestes lui tenait à cœur.
Et vous, personnellement, y a-t-il un geste ou une parole qui vous a particulièrement marqué?
Oui, il avait ce geste du pouce levé. C’était un petit signe pour dire «bravo», «on continue», «en avant»… Et puis, le jour de mon départ, il m’a remercié à plusieurs reprises. Pas juste un «merci» de convenance, mais une vraie reconnaissance. C’était fort.
Avez-vous eu des échanges personnels ou spirituels avec lui?
Non, pas vraiment. Mais sa manière d’être, ce regard humain qu’il posait sur les gens, ça en disait long sur sa foi et sa manière d’incarner son ministère.
Faut-il être croyant pour travailler aussi près du Saint-Père?
Oui. Toutefois, je parlerais d’un équilibre à trouver: être un peu soldat, un peu croyant. Si on est trop croyant, on peut être déçu par le service, parce que ça reste un cadre militaire. Et si on est trop militaire, ça ne fonctionne pas non plus. Il y a une dimension supplémentaire qui vous étreint…
Avez-vous parfois été grandement inquiet pour sa sécurité?
Le voyage qui m’a le plus impressionné, c’était à Bagdad. Le dispositif mis en place était impressionnant. Le matin, on est sortis pour préparer la journée, et tout le périmètre avait complètement été évacué.
Et lui, le pape, avait-il l’air angoissé, parfois?
Il ne voulait même pas de véhicule blindé. Il disait: « Si le pape doit mourir tué, ce sera sa croix.»
Justement, il aimait aller toucher la main des fidèles. C’était compliqué à gérer, non?
Oui, parfois il y avait des situations cocasses. On pensait que c’était terminé, la papamobile rentrait, et il disait : «Je ne suis pas passé par là-bas…» Alors on faisait demi-tour pour qu’il salue les personnes oubliées. Il y tenait vraiment.
Et dans certains pays, j’imagine que ce n’était pas évident pour les services de sécurité…
Exactement. Dans certains pays, la sécurité nationale ou les gardes du corps des chefs d’État ont pour mission d’empêcher tout contact physique. Là, c’était l’inverse. Il fallait faire venir les gens, permettre un échange, même bref. C’était notre rôle d’expliquer cela et de calmer un peu les nerfs de ceux pour qui ce genre de contact était impensable.
Le pape a été dans la ligne de mire de l’État islamique ou de certaines mafias. Votre expérience à Fedpol à Berne en tant que chargé de la traque des mafias vous a-t-elle été utile au Vatican?
Non, parce que la Garde suisse pontificale n’a pas une fonction de police. On assure la sécurité, mais on ne fait pas d’investigation ni de renseignement. En revanche, avoir eu certains contacts, notamment en Italie, ça m’a rendu service. Et parfois, en déplacement, je retrouvais d’anciens homologues. Ça ne m’a pas servi directement pour la sécurité du pape, mais ça facilitait les choses en termes de réseau.
Comment le pape se comportait-il lors de cérémonies officielles, notamment avec les chefs d’État?
Je ne suis pas sûr qu’il aimait beaucoup ce côté mondain. Il tenait surtout à rester simple et humble. Ce qui m’a beaucoup marqué, c’était sa capacité à s’adresser à des enfants dans la journée avec un langage très adapté, et à prononcer un discours à des chefs d’État le soir même. Il avait cette force d’adaptation, ce côté caméléon.
Est-ce que vous gardez un souvenir personnel de lui chez vous?
Oui, j’ai une photo de lui au-dessus ma bibliothèque. Elle m’accompagne depuis le début de mon mandat.
Vous avez aussi côtoyé Jean Paul II à 20 ans, lorsque vous étiez hallebardier. Un style très différent?
Oui, deux personnes issues d’environnements très différents. La Pologne d’un côté, l’Argentine de l’autre. Et pour tous les deux, un grand sourire et une vraie disponibilité.
Votre famille vous a accompagné dans cette mission. Comment ont-ils vécu cette parenthèse?
Plutôt bien, chacun à sa manière. La petite avait 7 ans, pour elle c’était une aventure. Le garçon, à 11 ans, a eu plus de mal. Quitter ses copains, son environnement… Et lui qui n’était pas très tactile, plutôt discret, il a eu du mal avec les accolades à l’italienne. Il a mis du temps à s’y faire. La grande, elle avait 13 ans, elle venait d’entrer dans le secondaire, c’était une bonne transition. Ils ont fréquenté l’Ecole suisse de Rome.
Et votre épouse?
Avant notre départ, elle était mère au foyer. Elle a gardé ce rôle durant toute la période à Rome. Cela m’a été d’un grand soutien. Vous savez, derrière un homme de pouvoir, il y a une femme de fer. Elle a été un pilier dans cette aventure.
Si vous deviez adresser un message à un jeune Suisse qui souhaiterait rejoindre la Garde suisse, que lui diriez-vous?
Je lui dirais: fonce. N’hésite pas. Cette aventure change un homme. Si tu ne le fais pas, tu le regretteras.
Et si vous aviez pu dire un dernier mot à François?
Je lui aurais moi aussi dit «merci». Merci pour ce qu’il a fait, pour son engagement sincère, pour tout ce qu’il a entrepris avec cœur. Et je souhaite à son successeur d’avoir autant d’écoute et de succès.